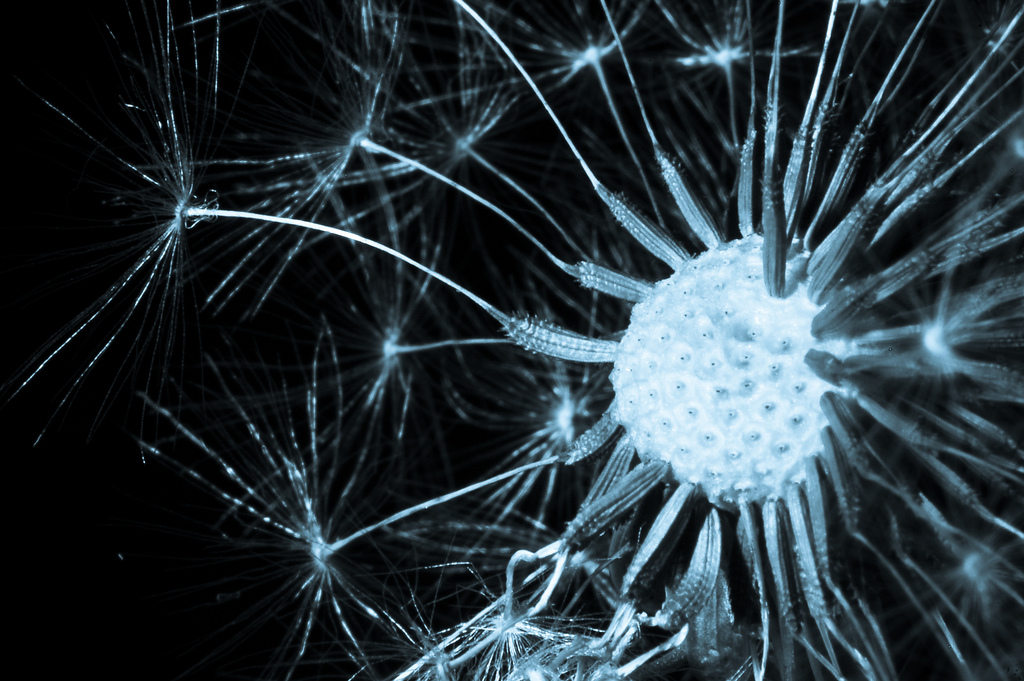Un patient atteint d’un trouble obsessionnel compulsif a été opéré à l’Hôpital Neurologique de Bron. Une première lyonnaise pour la neurochirurgie fonctionnelle, technique récente aux résultats encourageants.
Les psychiatres l’appellent la “folie du doute”. Le trouble obsessionnel compulsif, ou TOC, concerne 2 à 3% de la population d’après l’Association Française de personnes souffrant de TOC. “L’obsession est une idée qui s’impose au sujet avec une telle force qu’il doit mettre en place des rituels de compensation pour y faire face”, explique le professeur Mohamed Saoud, responsable du service de psychologie médicale à l’Hôpital Neurologique P. Wertheimer de Bron. Une personne atteinte de TOC sera consciente de l’absurdité de son obsession mais incapable de ne pas réaliser les rituels qui lui sont associés. Dans près d’un tiers des cas, les patients souffrant de TOC sont pharmacorésistants : le traitement ne fait pas disparaître le symptôme. Quelle solution leur proposer?
Des techniques alternatives aux médicaments
La neurostimulation non invasive, technique consistant à envoyer un courant électrique dans une zone ciblée du cerveau, est déjà employée depuis plusieurs années par le service du Professeur Saoud : le patient porte une sorte de serre-tête équipé d’électrodes placées à des endroits précis du crâne. On appelle cette méthode la stimulation magnétique transcrannienne à stimulation continue (tDCS). L’équipe du Professeur Saoud a ainsi été la première au monde à traiter par tDCS les hallucinations auditives dont souffrent les patients schizophrènes. La méthode a également fait ses preuves dans le traitement de la dépression.
A l’été 2015, l’équipe SIPAD du professeur Saoud a réussi une première lyonnaise avec les professeurs Stéphane Thobois, neurologue, et Marc Guénod, neurochirurgien : l’utilisation d’une technique de neurochirurgie fonctionnelle. Cette technique est également basée sur la stimulation cérébrale, mais cette fois sous une forme dite invasive, avec des électrodes implantées directement dans le cerveau du patient. La neurochirurgie fonctionnelle est testée à Lyon dans le cadre de STOC 2, le deuxième volet d’un programme hospitalier de recherche clinique national.
Deux semaines après l’implantation des électrodes sous anesthésie locale, le patient est opéré sous anesthésie générale pour recevoir cette fois la pile 9V qui garantit le fonctionnement des électrodes pendant sept ans. Quelques “réglages” sont ensuite nécessaires pour trouver le seuil moteur : c’est l’intensité de courant minimale qui, appliquée au cortex moteur primaire, permet d’obtenir 5 contractions involontaires du pouce pour dix stimulations. Chaque individu a son propre seuil moteur, qui dépend de l’épaisseur du crâne, de la forme de la tête, de l’excitabilité corticale et éventuellement de l’effet de médicaments.
Une fois les “bons réglages” trouvés, le traitement commence, ciblé sur le noyau subthalamique et le noyau caudé : une électrode permet d’activer et l’autre d’inhiber les zones choisies. Une quinzaine de séances d’environ trente minutes suffisent. “Les résultats sont réellement spectaculaires”, assure le Professeur Saoud.
Naviguer dans le cerveau pour le soigner
Les médecins ne ciblent évidemment pas au hasard les zones du cerveau concernées par la neurostimulation. Ils partent des données de la neurophysiologiques obtenues par l’imagerie cérébrale : “Le schéma cérébral est propre à chaque affection”, explique le professeur Saoud. Dans le cas de la schizophrénie, par exemple, les hallucinations auditives sont dues à une hyperactivité du cortex temporal auditif : il faut inhiber cette zone pour les faire disparaître. Avant toute neurostimulation, le patient va donc subir une IRM puis les images seront envoyées dans un centre parisien, qui renverra quelques heures après les coordonnées précises d’implantation des électrodes.
La neurostimulation apparaît donc sûre, économique et relativement peu risquée par le patient (le principal risque, celui de provoquer une crise d’épilepsie, est considéré comme faible à modéré). Ce qui explique que son usage s’étend à un nombre croissant d’affections psychiatriques, de la dépressions à la maladie de Parkinson en passant par les troubles du comportement alimentaire et les TOC. Si elle est réservée pour l’instant aux patients pharmacorésistants, son usage pourrait s’étendre à (presque) tous : “Cela a un côté inquiétant, bien sûr, notamment parce qu’on multiplie les intervenants autour du patient et que seuls les aspects physiologiques sont pris en compte”, reconnaît le professeur Saoud.
“D’un autre côté, très peu de nouvelles molécules sont mises au point : c’est valable pour tous les domaines, mais particulièrement en psychiatrie. Et ce serait inhumain, non éthique, de laisser des personnes en grande souffrance sans soins : le patient que nous avons opéré cet été ne pouvait plus travailler depuis 10 ans.” Pour lui, la technique chirurgicale est complémentaire à la thérapie classique mais ne la remplace pas : “Ces patients sont des gens qui doutent : le traitement par neurostimulation ne fait pas disparaître ce doute, il est simplement moins gênant.”